Le rêve et l'engagement : réalités et illusions d’un étudiant antillais pendant les années 1960 Jean-Pierre Asselin de Beauville
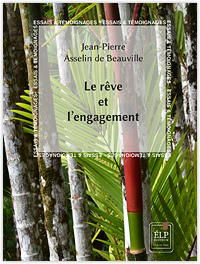
Dans l’odeur douce et sucrée de la farine de coco (ÉLP éditeur, 2023), Jean-Pierre Asselin de Beauville évoque son adolescence en Martinique. Dans Le rêve et l’engagement, un récit qu’on peut lire séparément du précédent, il se penche sur ses premières années d’études en France – désignée comme étant la Métropole. Pétri de rêves, idéaliste, il flirte avec des idées d’indépendance pour son île natale. Ses rêves de révolution le conduisent même à s’installer dans cette Algérie, nouvellement libérée, où il découvre une autre culture et participe à l’excitation entourant l’émancipation des pays d’Afrique. Dans l’euphorie de la décolonisation, il s’implique et milite au sein de l’Association générale des étudiants martiniquais. De retour sur son île natale, confronté à « la vérité du terrain », il se résout à mettre en veilleuse ses idéaux de séparation. Il repartira en France y effectuer son service militaire – obligatoire au début des années 1960 et terminer ses études supérieures.
Le rêve et l’engagement est le récit de la rupture. Rupture entre l’adolescence et l’âge adulte, entre les aspirations et la réalité – qui malheureusement nous rattrape toujours. Dans cette autofiction, rédigée dans un style aussi élégant qu’efficace, Jean-Pierre Asselin de Beauville restitue avec brio l’atmosphère particulièrement stimulante des années 1960. Un temps où tout était (encore) possible.
Après une carrière de professeur d’université et de scientifique dans le domaine de la reconnaissance des formes, Jean-Pierre Asselin de Beauville s’est converti à l’écriture littéraire et a notamment publié deux romans, C.Q.F.D. ou la diagonale de l’exil (Echo-éditions, 2020) et Il était une fois le Quenada (ÉLP éditeur, 2022).
Première diffusion : 9 octobre 2025
Poids : lourd | Prix sur 7switch : 4,99 € - 6,49 $ca | Collection : Essais et témoignages
Acheter sur : 7switch | iTunes | Amazon.fr | Amazon.ca | Kobo | etc.
La version papier de cet ouvrage est disponible sur Amazon, notamment sur Amazon Canada.
ISBN: 978-2-925555-03-2
Extrait 1 :
Ces grandes vacances furent, sans doute, parmi les plus belles de mon existence. Libéré du poids du baccalauréat, excité par la perspective de quitter l’île pour l’Hexagone, j’entrepris de profiter pleinement de mon temps libre. En attendant le début de mes études supérieures, j’étais libre de toutes contraintes scolaires notamment. Papa m’exhortait à réviser mes connaissances afin de ne pas prendre de retard lorsque j’entreprendrai les études de sciences physiques que j’envisageais. Mais tout à l’euphorie de l’avenir exaltant qui miroitait à mes jeunes yeux, je n’entendais nullement prendre en compte ses conseils. D’autre part, sans doute par suite de mon nouveau statut de bachelier, mon père me laissait la bride sur le cou, contrairement à ses habitudes. Mes journées se passaient, le plus souvent au lit à dormir et à lire les nombreux livres qui figuraient dans la bibliothèque familiale. Il fallait, en effet, que je récupère des fatigues causées par les nuits blanches passées en compagnie de mes amis. Je me suis plongé avec délice dans la lecture de *Le diable au corps *de Raymond Radiguet. Les aventures amoureuses du jeune héros de ce roman me faisaient fantasmer. *Vipère au poing* d’Hervé Bazin me permît de revivre certains conflits familiaux qui avaient eu lieu plus souvent entre mon père et moi. L’humour, la truculence et l’érotisme des romans de Marcel Aymé (La jument verte, Le passe-muraille, La Vouivre) nourrissaient mon imaginaire déjà fertile. La lecture du Marquis de Sade (Justine ou les malheurs de la vertu) me fit découvrir des aspects cachés de l’âme humaine tout en me permettant de satisfaire partiellement certains besoins sexuels [...] Dans ma boulimie de lecture je ne laissais rien de côté ni les livres sur la France, ni ceux sur l’Afrique, ni même la série des Angélique que maman lisait.
Extrait 2 : À propos d'une poignée de main à Che Guevara en Algérie
En mars 1963, à l’occasion de la célébration du premier anniversaire de l’indépendance, le gouvernement algérien invita le grand révolutionnaire cubain, Che Guevara, à visiter l’Algérie. Une réception fut organisée en son honneur dans le fastueux Palais du Peuple à Alger. Grâce à l’entremise de nos aînés et notamment de notre compatriote et ami Danny, Gigua et moi avions été invités à cette réception en tant que « représentants de la jeunesse Antillaise anti-colonialiste ». L’édifice situé sur les hauteurs d’Alger, dans le quartier d’El Biar, est au centre d’un grand parc paysagé où les palmiers viennent souligner le caractère ottoman de son architecture. J’étais émerveillé par la beauté de cette construction, par la finesse de ses arcades, par les dentelles de pierres qui ornaient les sommets des façades, par les mosaïques colorées qui décoraient le sol et certaines parties des murs… C’était la première fois que je découvrais tant de beauté et de luxe dans un bâtiment algérien. La Casbah et les mosquées visitées jusqu’alors ne m’avaient jamais autant impressionné.
À l’intérieur, nous fûmes reçus par les représentants des autorités algériennes parmi lesquelles figuraient le Président Ahmed Ben Bella et son ministre de la Jeunesse, des sports et du tourisme, le jeune Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier avait l’air d’un jeune premier souriant et dynamique. Sa jeunesse était pour nous une révélation, car, en France, nous n’étions pas habitués à voir des ministres aussi peu âgés. Le Président Ben Bella arborait pour la circonstance une austère tenue Mao, avec son veston sans encolure. Bien que relativement détendu, il paraissait par moments perdu dans ses pensées.
Vint ensuite le moment que nous attendions tous, celui où nous fût présenté le Che. Il était tel que nous l’avions vu représenté dans les médias. Très souriant, pas très grand, portant sa barbe légendaire qui était plus un collier qu’une véritable barbe, une légère moustache était visible sur son visage. Il était coiffé de son habituel béret décoré d’une simple étoile et habillé de son traditionnel treillis militaire. Il nous serra la main en nous encourageant à poursuivre le combat contre les impérialistes français. Ce qui me surprit était le fait qu’il pouvait s’exprimer en français sans que cela semble lui poser de problème. Par la suite, il fut happé par les officiels et nous n’avons plus eu l’occasion de lui reparler. Nous sommes restés marqués par cette rencontre et j’avais le plus grand mal à réaliser que je venais de donner la main au Che… Une telle rencontre, pour les apprentis révolutionnaires que nous étions, produisit en nous des effets encourageants qui perdurèrent longtemps…
Extrait 3 : À propos de la Chine
D’une façon générale, le peuple chinois nous est apparu comme un peuple travailleur qui ne s’adonnait à la paresse que très rarement. J’avais pour preuve de cela l’absence quasi totale de mendiants sur les espaces publics. Un jour, je vis un pauvre bougre assis sur un trottoir. Un pèse-personne à ses côtés, il proposait aux passants de les peser contre une petite contribution financière. Partout autour de nous nous ne voyions que des gens actifs et occupés à remplir des tâches d’intérêt général ou particulier. Je ne pouvais manquer de comparer cette situation à celle de mon île où l’assistanat mis en place par le colonialisme français avait poussé nombre de Martiniquais à vivre sans rien faire d’autre que d’attendre le versement des allocations familiales.
On percevait la société chinoise encadrée et contrôlée à tous ses niveaux. Lorsque nous visitions les monuments du patrimoine et que la foule était nombreuse, des sortes de gardes-chiourmes apparaissaient et faisaient régner la discipline dans la file d’attente, en allant parfois jusqu’à frapper les gens avec des baguettes en bois. Dans les gares ferroviaires, on apercevait, aussitôt que le train s’arrêtait, une armée de petites mains se précipiter sur les wagons pour les astiquer. Le nettoyage se pratiquait aussi à l’intérieur des voitures. De cette façon, les wagons étincelaient, au point que l’on aurait pu les croire neufs. Partout dans ce pays, il nous semblait voir la concrétisation de la parole de Confucius « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher plutôt que de lui donner un poisson ».
Dans les villes, les gens étaient généralement tous habillés proprement et portaient presque toujours la « tenue Mao », soit un pantalon et une veste de toile avec un col au ras du cou de couleur grise ou kaki. C’était une sorte d’uniforme. Ce qui était surprenant pour un Occidental était que cet uniforme était porté aussi bien par les gens du peuple que par ceux de la classe dirigeante. Aloyse, en fin observateur de la situation, me fit remarquer que, selon lui, une différence essentielle entre la Chine et son pays le Sénégal était liée à l’encadrement de la population. Ici, du plus bas de l’échelle sociale jusqu’au niveau le plus élevé, le Parti communiste était présent et intervenait, aussitôt qu’un risque de dérapage apparaissait. La règle, fixée par le Parti, était la même pour tous, dans l’ensemble du pays. Au Sénégal, le plus souvent, et surtout dans les villages les plus éloignés de la capitale, les gens étaient livrés à eux-mêmes ou à des potentats locaux qui fixaient leurs propres règles. En tous cas, même si nous percevions des écarts de niveau de vie entre la classe paysanne et la classe ouvrière et, plus généralement les citadins, ces écarts restaient contrôlés et ne semblaient pas susciter de révolte chez les plus pauvres. L’ensemble de la population paraissait tourné vers un même objectif : le développement de la société chinoise en vue d’améliorer sa qualité de vie.
