Philosophie pour les penseurs de la vie ordinaire, un essai de Paul Laurendeau
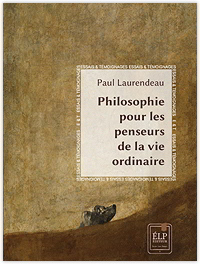 Cet ouvrage cultive, le plus simplement possible, la propension philosophique qui est celle des penseurs et des penseuses de la vie ordinaire. La philosophie est partout. Nous la pratiquons tous et la mobilisons aussi souvent que nous réfléchissons sur un problème, petit ou grand. Nous recherchons tous le déterminant, le fondamental, le généralisable, la vérité. Mais, les choses de la division du travail intellectuel étant ce qu’elles sont, en notre petit monde social, on se retrouve ni plus ni moins que des sortes de Monsieur Jourdain de la pensée générale. On fait de la philosophie sans le savoir.
Cet ouvrage cultive, le plus simplement possible, la propension philosophique qui est celle des penseurs et des penseuses de la vie ordinaire. La philosophie est partout. Nous la pratiquons tous et la mobilisons aussi souvent que nous réfléchissons sur un problème, petit ou grand. Nous recherchons tous le déterminant, le fondamental, le généralisable, la vérité. Mais, les choses de la division du travail intellectuel étant ce qu’elles sont, en notre petit monde social, on se retrouve ni plus ni moins que des sortes de Monsieur Jourdain de la pensée générale. On fait de la philosophie sans le savoir.
Il s’agit, dans cet ouvrage, de parler de tout cela, ouvertement. On aspire ainsi à promouvoir une rationalité méthodique, ordinaire, usuelle, pas trop compliquée, pas trop spécialisée, honnête, directe, sans trucage… et qui est déjà bien présente en nous. Observer philosophiquement le monde, c’est mobiliser un type particulier d’abstraction intermédiaire. Il ne faut pas rester trop concret mais il ne faut pas devenir trop général non plus. Il faut se tenir tout juste à bonne distance du réel qu’on entend appréhender. Juste assez haut pour produire des généralisations cohérentes et juste assez bas pour retourner au concret et solidement engager l’action que la pensée appelle et encadre. Abstraction intermédiaire. C’est là quelque chose qui se dose et qui se dégage, au fil des observations, des réflexions et des conversations qui nous définissent.
Faire de la philosophie en le sachant, c’est un peu l’air d’aller intellectuel de notre nouveau siècle. La pensée fondamentale est un grand exercice collectif, parfaitement ordinaire.
Première diffusion le 31 août 2021.
4,99 € - 6,49 $ca sur 7switch | Poids lourd | Collection Essais
Acheter sur : iTunes | Amazon.fr | Amazon.ca | Kobo | etc.
ISBN : 978-2-924550-61-8
L’être humain est un coupeur d’oignon larmoyant / par Allan E. Berger
Cela fait plusieurs millénaires que les humains philosophent. Mais cela ne fait que peu de générations qu’il semble falloir posséder un diplôme de philosophie pour, en Francophonie tout du moins, avoir le droit de philosopher sans blâme. Alors enfin quoi, réveillez-vous : du temps de Camus encore, on philosophait sans tampon. Mais à l’époque de BHL il en faut, ainsi que d’efficaces parrainages pour éviter de s’entasser avec la plèbe sous les plafonds de verre. Donc voici un peu une captation d’héritage, il me semble bien, oui ?
Il ne faudrait quand même pas croire que, sous prétexte que les accapareurs passent à la télévision, écrivent des livres et produisent des éditoriaux, ils auraient le droit de décider qui peut philosopher, et qui sera juste ridicule et au-dessus de sa condition : quelque chose comme « à vous le bistro, à nous la radio ». C’est de légitimité qu’il s’agit là : et puisque la philosophie politique, mais pas qu’elle, s’attache à la poursuite de la légitimité en tant qu’objet de recherche, il est assez cuisant de voir ses adeptes s’entre-légitimer au mépris de leurs propres principes, à l’aide souterraine d’un petit syllogisme biaisé que je vous laisse découvrir.
Les grands de ce monde énoncent, à la radio par exemple, assez souvent d’énormes bêtises, que personne ne relève dans la sphère médiatique car chacun tient à sa bonne petite place ; c’est ainsi que le consommateur de culture, en toute bonne foi, s’empoisonne peu à peu, en abandonnant son droit de comprendre à celles et ceux qui veulent lui faire croire plutôt que savoir ou ignorer.
Et les prescripteurs, même quand ils s’activent depuis la sphère de la contre-culture ou de l’alter-monde youtubé façon Greg Tabibian ou (soutenons la biodiversité et citons le machin nommé :) Alain Soral, s’enferment dans un format de posture qui est celui dont dépend, peu à peu, leur notoriété, et qui dépend, lui, de leurs propres croyances bien ou mal assumées. Alors, quand même un Joueur du Grenier en vient à se faire accuser de pensées suspectes, l’internaute, qui se méfie déjà des médias privés comme d’une pleine seringue d’Ebola, ne sait plus quoi faire.
Heureusement soudain arriva Laurendeau, qui décida, en bon petit super-Locke, de commettre un ouvrage de philosophie basique : qui a dit quoi, quelles sont les fondations de tel édifice, quels pièges se tapissent dans telle façon de penser ? Voici quelques tuteurs désinfectés : sauriez-vous vous construire vous-même en les utilisant ? Mais je vous en prie, examinez-les d’abord, on ne sait jamais. N’allez pas croire, surtout.
La philosophie c’est comme la politique : elle est à tout le monde et sans elle on ne va nulle part. Ne pas s’en occuper vous retire (à mes yeux) le droit de râler. Même au bistro. Voilà. Alors monsieur Laurendeau, que les captateurs d’héritage hérissent et rendent grognon comme le loup des histoires, s’est dit : « Nom d’un lapin, on va pas se laisser faire ; la philosophie c’est fait par les humains et pour les humains, pas par des cuistres pour des moutons ! »
Il a donc tout repris, bien assaini le paysage en partant de principes clairs et simples, exposé ce qui ne tient que par l’imposture ou par erreur sacrée, et amené jusqu’à vous de bons petits outils pour vous permettre de déblayer vous-même tel ou tel secteur qui vous attirerait. Il a eu l’honnêteté de préciser d’emblée d’où il parlait, d’où il pensait, d’où il espérait ; comme ça, si vous n’êtes pas d’accord avec lui, vous saurez pourquoi. Et comme monsieur Laurendeau ne tient pas à faire carrière, il se retire et vous laisse avancer. Bref : voici un texte plein de bonne santé et pétaradant de joyeuse humeur, qui peut vous apprendre à apprendre.
Il faut ! Il faut… Eh oui, il faut. Il faut, pardonnez-moi mais c’est comme ça, il faut prendre son courage et ne pas reculer devant les mots spéciaux qui, dès le début de l’ouvrage, introduisent aux notions de base de la philosophie et de la pensée politique occidentales. Ils ne mordent pas, ces mots, et ce qu’ils disent est crucial ; ils sont explicités par l’auteur avec gentillesse et le plus de clarté possible, car cette personne n’est pas là pour vous en mettre plein la vue (admirez-moi comme je cause bien, sales gueux ignares) mais pour vous mettre plein la vue de tout ce qu’il y a à voir, et que l’on ne voit ordinairement que très peu, ou mal. On peut remercier l’auteur d’avoir été à ce point pédagogue car ce livre, qui dès le début nous a emmené loin, va devenir passionnant.
Comme la pensée humaine est vaste, et qu’elle est parfois compliquée, que les notions qui en émanent sont parfois tout sauf évidentes, rien ne vaut quelques bonnes paraboles, ou allégories, ou simples images : j’ai bien aimé l’utilisation par l’auteur des oignons, du poulet et des cubes de glace.
Après ce joyeux défilés suivent quatre chapitres suprêmes où, lectrices-lecteurs, maintenant qu’on vous a bien équipés, vous allez vous attaquer aux domaines suivants : l’humain, les religions, l’Histoire et le politique. Et c’est à crever tant c’est passionnant. Mais c’est passionnant parce que tout cela nous concerne jusqu’au plus intime.
Mais alors ainsi donc, et même cependant, car bon il faut quand même bien s’en inquiéter, pourquoi l’être humain serait-il un coupeur d’oignon larmoyant ? Vous voulez le savoir ? Allez savoir. Peut-être aurons-nous un bout de réponse dans l’extrait qui suit.
Un extrait savoureux
Construire un modèle est un comportement mental très commun et très ordinaire. Ça consiste à établir des liens logiques entre différentes réalités et suggérer que telle portion perceptible (empirique) du réel est un organon (un outil de la pensée) permettant de se représenter telle portion vaste et non-empirique du réel. Un globe terrestre est un modèle et, de fait, des enfants assez jeunes en viennent à comprendre assez vite que cette sphère est une représentation, en petit, du vaste monde qu’ils habitent. La modélisation est une propension logique ancienne et profonde. Nous en exemplifions le fonctionnement ordinaire ici, avec un abricot et un oignon…
Mais la propension logique ne se restreint pas à la construction de modèles. Les problèmes de la philosophie ordinaire s’imposent de façon constante et pressante à l’esprit. On va donc en venir à confronter les modèles. On va observer que certains modèles entraînent le raisonnement rationnel dans une direction et que certains autres modèles entraînent un raisonnement aussi valide dans une direction contraire. Ce sera la dialectique (logique opératoire dans le contradictoire) des modèles. Il faudra alors approfondir l’observation et le raisonnement pour dégager quel modèle a une prépondérance ontologique sur quel autre… sans que le mérite de l’autre ne disparaisse pour autant. Nous exemplifions cette lutte logique des contraires avec du poulet et des cubes de glace…
[…]
On s’efforcera d’abord de faire la distinction entre un modèle ontologique et un modèle cosmologique. Un modèle cosmologique prendrait position de façon physique ou matérielle sur ce que le cosmos revêt, en principe, comme forme effective. Assez simplement, dans un style un petit peu héraclitéen, on peut suggérer que le fleuve ou la flamme sont des modèles cosmologiques élémentaires, puisque le cosmos est possiblement une grande entité mouvante et flacotante contenue dans un dispositif plus vaste qu’elle intègre et fuit en permanence (fleuve) et dont, en même temps, l’existence est une avancée fugitive et hâtive vers sa finalité de destruction (flamme). Un modèle ontologique est moins concret ou tangible que cela, dans la réflexion qu’il propose. Une sorte de jeu d’abstractions simplettes s’y manifeste. Il s’agit moins d’imiter le cosmos, comme un globe terrestre imite la Terre effective, que de formuler une réflexion ontologique généralisable, de nature solidement métaphorique ou analogique, entre le modèle ontologique et les catégories principielles qu’il aspire à mettre en saillie. Un modèle cosmologique schématise une configuration matérielle. Un modèle ontologique fait penser sur un ensemble de problèmes corrélés concernant l’être. On va regarder comment cela fonctionne avec l’oignon.
Et, dans cette réflexion sur l’oignon comme modèle ontologique,
nous partirons… d’un abricot.
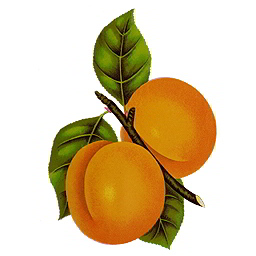
L’abricot est binarisé. Il nous donne, lorsque tranché, l’image nette et démarquée d’une chair molle et d’un noyau dur. La chair molle représente son présent (comestible, putrescible, transitoire), le noyau représente son avenir (dur, rébarbatif, immangeable, il faudra le planter pour en tirer quelque chose). Fatalement, et assez directement, le modèle ontologique de l’abricot nous ramène à la vieille dyade d’idées aristotéliciennes de l’essence et de l’accident. L’abricot conjoncturel est ce qu’on mange, l’abricot essentiel est ce qu’on plantera pour qu’il nous revienne. Le raisonnement implicite ici mise sur un avenir linéaire, une continuité agraire, un ordre convenu. Il y a un avant et un après. Tout, dans ce modèle ontologique, opère comme un binarisme.
Le modèle binariste (modèle de l’abricot) est, de fait, encore largement dominant, notamment dans la pensée occidentale. Toujours un peu prétentiarde, même en matière de philosophie vernaculaire, la pensée commune aime peler ce qu’elle décrète trivial et inviter ostensiblement à la recherche du ci-devant noyau dur. Noyau dur, radicalité, essence secrète de la chose, superficialité des scories aussi. On est souvent, en pensée ordinaire, dans le modèle de l’abricot. On cherche les chefs, les éminences grises, les forces motrices secrètes, les abris anti-nucléaires, les trésors cachés, les clefs de lecture, le centre de la terre.
C’est donc souvent avec le modèle ontologique de l’abricot à l’esprit qu’on aborde l’oignon. L’oignon se pèle facilement. Dorée, superficielle et d’une finesse éminemment craquelante, sa peau de surface ressemble à du papier friable. Il n’y a rien à tirer de cette fine surface de l’oignon. On va donc se mettre à le peler rapidement. La peau, à mesure que l’on pèle, s’humidifie et elle s’épaissit un petit peu. Mais qu’importe, elle reste peau, surface, accident. On a bien hâte de le trouver, le noyau, et de voir de quelle manière éclatante il s’imposera à notre conscience. Or, il n’y a pas de noyau. Il n’y a que la peau de l’oignon et ce, jusqu’au fond, jusqu’au centre, jusqu’à l’autre pourtour.
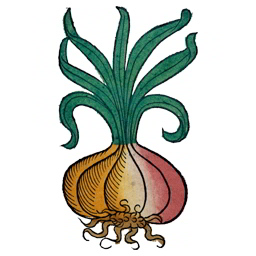
L’oignon est un modèle moniste. Il ne contient que lui. Il ne cultive pas la distinction entre le dur et le mou, le radical et le superficiel, l’essence et l’accident, le pourtour et la substance. Tout est radical dans l’oignon ET tout y est superficiel aussi.
L’oignon, c’est comme un peuple ou comme un concerto. Cherchez l’élément essentiel d’un concerto, vous chercherez longtemps. Un concerto n’est pas un noyau dans son emballage de nutriments. C’est un déploiement unitaire, unaire. Il est une entité où chaque note compte, ni plus ni moins que l’autre. Pour appréhender le concerto, il faut l’approcher dans son intégralité. Pour manger l’oignon, vous devrez mettre à frire presque tous les différents feuilletés de peau que vous aviez cru initialement négligeables. Un peuple n’a pas pour noyau ses rois, ses chefs, ses rupins ou ses classes dominantes. Traitez le peuple comme peau négligeable et flagossez avec les chefs et les rupins, vous raterez totalement votre rendez-vous avec un grand peuple au profit de mondanités inutiles avec des petits tocs. La rencontre cruciale se vit au troquet et non au palais. On sait ça depuis Voltaire, et même avant.
Nous voici donc avec, face à face, deux modèles ontologiques : l’abricot binariste et l’oignon moniste. Pourquoi en valoriser un plutôt qu’un autre ? N’est-ce pas de leur confrontation que jaillira une pensée féconde ? Absolument. Jouons ce jeu logique, donc.
L’oignon illustré provient de la Welcome Library sous license (CC BY).
Fichier disponible ici.
Quant à l’abricot, il est en copyleft et on peut le découvrir ici. Voilà.
Pour un optimisme progressiste et militant
En art comme dans la vie usuelle, le développement historique n’est ni linéaire, ni ondulatoire, ni pendulaire, ni cyclique. Il avance par vastes phases, par bonds immenses et d’une manière accidentée et irréversible. Les grands changements qualitatifs s’instaurent et les progrès (reconfigurations sociales, avancées technologiques, affinements intellectuels) mettent en place des états de fait historiques radicalement nouveaux.
Une question axiologique se pose alors, inévitablement. Assiste-t-on à une détérioration ou à une amélioration des conditions historiques ? J’ai parlé plus haut (autour de la question du progrès social corrélé à la condition des femmes) de l’inadéquation du pessimisme militant. Ce dernier est une tendance velléitaire, qui ne désarme pas facilement. Il croit, en toute bonne foi, dominer l’analyse d’une situation sociologique du simple fait d’en dire du mal, sur un ton revêche ou marri. On n’échappe jamais complètement à une telle propension. Et pour faire tinter au mieux le son d’un militantisme sérieux et vachement impliqué, on s’imagine souvent qu’il faut décrier la situation qu’on combat plutôt que de la décrire. Décrier pour décrire, c’est pas fort. Et c’est là le tout de l’illusion critique que cultive justement le dénigrement, comme méthode d’analyse au rabais. Le pessimisme militant végète dans un vivier moraliste illusoire. Ses options idéologiques nous forcent à fermement soulever la question de sa pertinence de vérité. Le bougonneux social procède-t-il à une appréhension adéquate du monde ? Nous sert-il une sorte d’analyse ardente qu’aurait affinée sa colère, cette version mal dominée de sa révolte ou de son affectation de révolte ? Je ressens l’obligation impérative d’en douter fortement.
Ma prise de parti philosophique sur le développement historique est plutôt celle de faire progresser un optimisme militant, s’appuyant sur une description solide du factuel. Notre combat pour la vérité et l’adéquation des rapports sociaux n’est pas un baroud désespéré. Nous nous battons pour une cause parce que nous misons que cette cause l’emportera. Dans une telle dynamique, le pessimisme militant démoralise et, de ce fait, il ne sert, fondamentalement, que les adversaires de notre vision du monde. Ceux-ci adorent le désespoir cinglant et la panique feutrée, surtout chez ceux qu’ils cherchent à tenir en sujétion.
Non, non et non. Le monde s’améliore et il peut s’améliorer encore. Encore mieux. Amplement mieux. En 1870, un bon 70% de la population de Londres (la capitale de l’Empire victorien d’alors, le premier du monde) vivait sous le seuil de pauvreté. En 1914, il fut parfaitement réalisable d’envoyer des millions d’hommes à la mort pour soutenir des causes nationales dont ils ne tiraient personnellement pas grand-chose, ni pour eux, ni pour leurs enfants. Et ces derniers rempilèrent en 1939. Et on faillit rempiler une troisième fois en 1962, pendant la Guerre Froide, mais une sorte de grand freinage planétaire eut alors lieu. Et je doute fortement qu’on rempilerait aujourd’hui… car l’histoire c’est pas seulement le développement des masses, c’est aussi une mémoire collective.
Aujourd’hui, les gens veulent vivre. Ils veulent que leurs jeunes enfants et leurs vieux parents se portent bien. Les gens veulent que la richesse se répartisse adéquatement, que les pays émergents se stabilisent, que l’eau potable humecte toutes les lèvres, que le sabotage climatique cesse, et que les injustices, les extorsions, les agiotages, les abus de pouvoir de tous tonneaux prennent fin. Aussi, s’il y a indubitablement lieu de questionner l’honnêteté de certains privilégiés, il est peu pertinent de douter de la bonne foi collective. Les masses tendent vers des configurations sociales optimales. Et, comme elles ne se donnent que les problèmes qu’elles peuvent résoudre, celui desdites configurations sociales optimales aussi, elles le régleront. En temps et heure.
Il faut refaire la vie et un jour viendra.
